Grandeur passée


Lauréat 2013 du prix littéraire le plus convoité, Pierre Lemaitre a également recueilli l’adhésion du public avec 550 000 exemplaires vendus d’Au revoir là-haut. Ce jeune romancier de 62 ans, dont la carrière n’a démarré qu’en 2006, s’était déjà fait un nom avec 5 polars très remarqués au style visuel qui le caractérise.
Plus de trois mois après le Goncourt, Pierre Lemaitre continue toujours de répondre à des sollicitations de toutes sortes, même si cela s’est calmé un peu. Outre les radios, télés, quotidiens et magazines qui ont tous voulu l’interviewer, il se trouve qu’en plus son roman colle à l’actualité des commémorations pour le centenaire de la Guerre 14-18, mais comme le souligne l’écrivain : « Il y a trop de sollicitations pour un seul homme, il faut faire des choix ». A cela s’ajoute aussi les nombreuses invitations des librairies à travers la France pour une séance de dédicace ou une animation, d’autant qu’ils ont beaucoup soutenu le roman dès sa parution : « Le succès de mon livre est aussi dû au dynamisme des libraires, et en ses temps de difficultés qu’ils traversent, il me semble loyal de rembourser ma dette symbolique en étant à leurs côtés ».
Des projets à la pelle
Cette effervescence l’a poussé à différer l’écriture de son prochain roman afin de retrouver la tranquillité nécessaire, mais il continue à prendre des notes et à se documenter. Selon toute vraisemblance, il sera question de l’exode de 1940 avec comme protagoniste un personnage secondaire d’ « Au revoir là-haut », dans une histoire qui pourrait aller jusqu’en 1960. Il poursuivrait ainsi l’idée d’écrire en plusieurs romans une fresque étalée sur un siècle : « Ce ne sera pas une suite au sens généalogique avec un personnage principal, mais plutôt une sorte de puzzle où chaque livre touche les autres par un coin, dans une méthode un peu balzacienne. Je ne suis pas un historien, en revanche cela me tente de donner une vision du XXe siècle à travers mon regard, mes valeurs, mes convictions. »
Entre-temps de nouveaux projets sont venus se greffer. Il travaille actuellement avec une équipe américaine sur l’adaptation cinématographique de l’un de ses romans policiers, « Alex », qui sera tourné à Paris à la fin de l’année. Comme l’on pouvait s’y attendre, « Au revoir là-haut » suscite également des transpositions. La première sera en BD avec le dessinateur Christian De Metter, et il commence aussi à être question d’en faire un film. Pierre Lemaitre apprécie cet exercice salubre pour l’hygiène intellectuelle : « La bande dessinée, comme l’adaptation d’un roman pour le cinéma, vous oblige à épurer l’histoire et le texte pour aller au cœur de l’action, cela rejoint ma devise qui est d’essayer de faire très bien des choses très simples. »
Le plus beau moment de sa vie
Bien évidemment, le Goncourt a changé la vie de Pierre Lemaitre, déjà en lui apportant une légitimité d’écrivain à part entière et une sérénité dans son métier. Lui l’auteur de polars, qui appartenait à un genre considéré comme n’étant pas très noble et qui a dû en souffrir, n’a jamais supporté les classifications. Il n’a d’ailleurs pas l’impression d’avoir changé de métier avec « Au revoir là-haut ». Ce prix lui a donné aussi une notoriété qui le transforme en personnage public dont la parole est plus surveillée, notamment par ceux qui ont contribué à son succès. Il a acquis également le bénéfice du temps pour écrire, ce dont rêve la plupart des écrivains. Pour un homme qui n’aime pas voyager, il va devoir y prendre goût puisque 25 traductions sont prévues de son roman, avec chaque fois un déplacement dans le pays à l’occasion de la sortie du livre.
Cette consécration, on l’a senti venir dès les premières sélections aux différents prix littéraires en septembre dernier, quand le roman de Pierre Lemaitre est apparu quasiment sur toutes les listes. L’écrivain n’avait pourtant pas le parcours typique qui pouvait laisser prévoir un tel engouement, mais il tente d’en expliquer les raisons : « D’abord, la tonalité de roman populaire avec un désir de renouer avec du romanesque, des rebondissements, de l’aventure. Ensuite, le thème de la Grande guerre qui est dans l’air du temps, mais que j’ai pris sous un angle inattendu pour les commémorations, à travers l’après-guerre avec un ton assez corrosif. Enfin, le succès auprès du public ayant commencé avant l’attribution du prix, il était salutaire que l’Académie Goncourt consacre un livre dont les ventes allaient aider la librairie. »
Traiter différemment la guerre 14-18
Ce n’est nullement pour coller à l’actualité du centenaire que Pierre Lemaitre a choisi d’écrire un roman sur la Première guerre mondiale, mais bien par passion depuis très longtemps pour cet événement qu’il juge majeur dans l’Histoire contemporaine. D’autant que le livre devait paraître en 2008, mais l’auteur qui avait plusieurs commandes simultanément n’a pu le terminer à ce moment-là. Comme beaucoup de livres avaient déjà été écrits sur cette guerre, il a préféré l’aborder en traitant l’après-guerre et en appuyant sur certains aspects méconnus, sans pour autant s’ériger en redresseur de torts : « L’industrie s’est nourrie de la guerre aussi bien avant, pendant qu’après, notamment avec le marché public des exhumations militaires où certains se sont largement engraissés. J’ai voulu aussi rappeler la manière dont les soldats qui sont revenus des tranchées ont été accueillis avec ingratitude, ce qui serre le cœur encore un siècle plus tard. »
Mieux vaut tard que jamais
En tant que lecteur, Pierre Lemaitre vient de la littérature de feuilleton sous toutes ces formes, qu’il dévore durant son enfance et qui se convertie naturellement en roman policier lorsque lui-même commence à écrire. Ses cinq polars publiés avant « Au revoir là-haut » ont été récompensés à la fois par des prix et un joli succès public, qui s’est étendu à l’international avec une traduction dans près d’une trentaine de langues. Il écrit également des scénarios pour la télévision, et assez rapidement après ses débuts, il arrive à vivre de son métier. Pourtant, cette carrière qui se déroule de la meilleure des façons pour le romancier, il ne l’a démarrée qu’à 55 ans grâce à la confiance que lui a donné une femme rencontrée au début des années 2000, devenue entre-temps son épouse. Aucun regret de ne pas s’être lancé plus tôt pour cet écrivain tardif, persuadé qu’il n’avait pas la maturité pour s’exprimer avec la même réussite qu’aujourd’hui.
Bernard Pivot, au moment de l’attribution du Goncourt à Pierre Lemaitre, a évoqué un roman populaire avec un rythme très cinématographique. Commentaire très juste que l’on peut appliquer à l’ensemble de l’œuvre du lauréat, qui se définit ainsi : « Je ne suis pas un écrivain angoissé de la page blanche mais plutôt un écrivain jubilatoire. Je travaille avec l’émotion que crée une scène, en m’amusant à l’écrire lorsqu’elle est drôle, et en étant ému dans le cas contraire. »
Une vie de littérature
La littérature a toujours été présente dans la vie de Pierre Lemaitre. Ses parents d’origine modeste la valorisaient en permanence, et après des études de psychologie, le futur romancier l’a enseignée en formation professionnelle notamment à des bibliothécaires durant de nombreuses années. Généreux et loyal, cet homme tranquille au parcours atypique qui reconnait être rancunier et s’emporter facilement, vit depuis huit ans pleinement son nouveau métier : « Il m’habite sereinement. Lorsque je n’écris pas, je pense à ce que je vais écrire. En regardant un film, je prends des notes. Je me lève la nuit pour consigner les idées qui me viennent dans mes rêves et ainsi ne pas les oublier. Quand je lis un roman, je me demande comment je m’y serais pris si j’en avais été l’auteur. » Maintenant qu’il a décroché le Graal, il va s’évertuer à le mériter en écrivant des romans et des scénarios de films dont on pourra se dire : « Finalement, lui avoir attribué le Goncourt n’était pas une erreur de casting. »
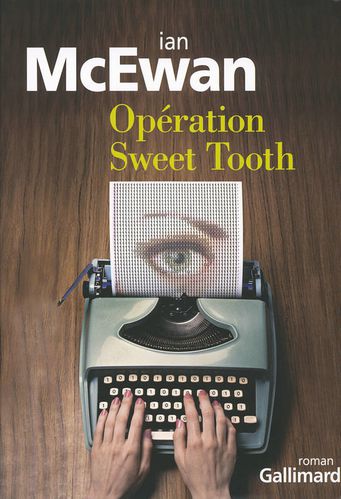
D’un roman à l’autre, Ian McEwan continue à la fois de bâtir une œuvre de tout premier plan et d’explorer l’Histoire anglaise de ces 50 dernières années. Le décor de son dernier petit bijou se situe dans les années 1970 dans un climat de guerre froide culturelle. Les services secrets britanniques enrôlant à leur insu des écrivains hostiles aux idées communistes, pour contrer la tendance très à gauche des intellectuels du moment. A 65 ans, le romancier anglais se sert une nouvelle fois de faits réels pour bâtir autour, de manière vertigineuse, une fiction qui avance crescendo jusqu’à un épilogue renversant. Si l’on peut voir ce roman comme une autobiographie détournée, puisque l’un des personnages principaux est un jeune écrivain dont les nouvelles rappellent celles de McEwan à la même époque, ce n’est là qu’une des nombreuses strates qui le composent. Mensonges, manipulations, ambigüité, ambivalence des personnages, l’auteur excelle en eaux troubles mais aussi dans la description de profonds sentiments amoureux, ou dans une subtile réflexion sur le pouvoir de l’écriture. L’humour est un ingrédient sous-jacent mais assez présent tout au long de ce roman parfois féroce avec ses personnages, qui met en évidence les contradictions d’une société anglaise mal en point dans ces années-là. La narratrice, une anglaise d’une soixantaine d’années, commence son récit en affirmant que 40 ans plus tôt, les services secrets britanniques lui ont confié une mission, dont elle n’est pas sortie indemne et qui a également détruit son amant. Sans s’attarder sur son enfance et son adolescence, elle nous présente sa famille et évoque les premières rencontres décisives de sa vie d’étudiante, notamment celle d’un professeur qui va être son mentor et son premier grand amour. Moins noir que dans ces précédents romans, Ian McEwan nous passionne en mêlant fiction et réalité avec maestria et une légèreté inhabituelle qui lui va très bien.
Opération Sweet Tooth – Un roman de Ian McEwan – Gallimard – 437 pages – 22,50 €.
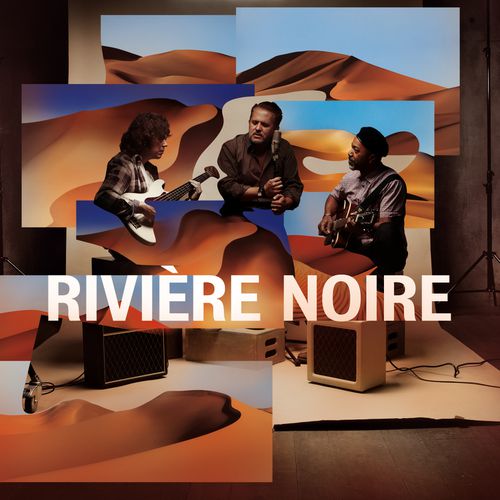
Ce premier album est une sorte de petit miracle qui est né de la rencontre de trois artistes confirmés ayant déjà bourlingué chacun de leur côté, et qui ont manifesté simultanément un désir d’Afrique. D’abord un chanteur brésilien réputé, puis un guitariste français d’origine guadeloupéenne ayant joué avec des pointures internationales, et un bassiste programmateur français magicien du son ayant travaillé avec Bashung, Noir Désir, Salif Keita et bien d’autres. Dès leur première rencontre à Paris, les trois compères trouvent instantanément l’inspiration, chacun amenant son univers tout en créant une harmonie musicale et une superbe cohérence. Pour que l’alchimie soit parfaite, ils partent à Bamako enrichir leurs créations avec de grands chanteurs et musiciens maliens qui viennent poser leur voix et instruments si émouvants sur les compositions du trio. Ce croisement de cultures et musiques qui se complètent et s’enchevêtrent à merveille donnent des compositions lumineuses allant d’une douceur exquise à des rythmes plus ou moins enlevés et souvent hypnotiques. A la suavité du chant brésilien répond l’intensité de celui de griots maliens sur une musique qui oscille entre folk, blues, sonorités africaines avec une pincée de rock ou d’électronique par moments. Cet album enchante par sa fraîcheur, sa spontanéité mais aussi l’émotion et la sérénité qui s’en dégagent sur les 14 morceaux, où guitare électrique et acoustique, basse, claviers, batterie convoquent une kora ou une calebasse dans un délicieux métissage. Au-delà de cette brillante idée de confronter des univers différents réunis autour d’un même amour pur de la musique, il y a surtout un somptueux résultat qui apparemment devrait avoir une suite sur d’autres lointains rivages.
Rivière Noire – Atmosphériques – 1 CD : 15,99 €.

Etonnant de prime abord de retrouver le réalisateur français Arnaud Desplechin dans cette aventure américaine, mais il suffit de voir le film pour comprendre qu’il poursuit le même chemin, mais sous des formes différentes. A 53 ans, le cinéaste trop rare d’ « Un conte de Noël » et de « Rois & reine », se sert cette fois d’une histoire vraie pour continuer à sonder les blessures de l’âme, et il le fait ici avec une humanité bouleversante. En arrière-plan de ce très beau film, on entrevoit les traumatismes laissés par la seconde guerre mondiale chez les soldats américains, ainsi que le massacre du peuple indien et les conséquences sur les survivants et les générations qui ont suivi. Les deux principaux protagonistes de cette histoire sont à priori très différents, un indien massif et un petit psychanalyste anthropologue français d’origine juive roumaine. Tous deux sont marginaux d’une société qui ne les comprend pas, et leur rencontre va s’avérer très positive pour les deux. Ces personnages sont admirablement interprétés par deux comédiens aussi dissemblables que complémentaires. La présence et le jeu magnétiques de Benicio Del Toro, mélange de puissance et de fragilité, ont un réel pouvoir de fascination. Mathieu Amalric quant à lui est à la fois drôle, touchant, exubérant. L’histoire démarre dans le Montana en 1948, un homme travaille dans le ranch de sa sœur et son beau-frère après avoir perdu son travail au retour de la guerre. Blessé au crane durant les combats, il est régulièrement sujet à de violents maux de tête, des troubles de la vue et de l’ouïe qui lui gâchent la vie. Sa sœur l’accompagne dans un hôpital militaire psychiatrique au Kansas pour trouver une solution à ses problèmes. Ce film subtil, romanesque, sensible, qui n’est pas dénué d’humour et où l’on pense parfois à François Truffaut, se révèle passionnant tant dans le fond que dans sa forme.
Jimmy P. – Un film d’Arnaud Desplechin avec Benicio Del Toro, Mathieu Amalric, … - France TV distribution – 1 DVD : 19,99 €.

Fondateur en 1991 et directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), Pascal Boniface, également enseignant à l’Université Paris 8 et passionné de sport, intervient régulièrement dans les médias et publie des ouvrages pour nous éclairer sur les enjeux stratégiques européens et mondiaux.
Pouvez-vous nous présenter l’Iris ?
Pascal Boniface - L’Iris est un centre de recherches qui intervient à la fois dans le débat public et en tant que conseil pour des décideurs économiques ou politiques, dans le domaine des relations internationales et de la géopolitique. Nous réalisons des études pour les gouvernements, les entreprises et les organismes internationaux. Parallèlement, nous organisons des séminaires et des colloques, publions une revue trimestrielle, proposons une formation tant professionnelle qu’initiale pour près de 300 étudiants. Nous avons un budget annuel de 2,8 millions d’euros, une trentaine de permanents répartis dans les différentes activités de l’Iris, et une quarantaine de chercheurs extérieurs qui collaborent régulièrement avec nous. Notre conseil d’administration est composé de personnalités politiques de gauche et de droite, de dirigeants économiques et de hauts fonctionnaires. L’Iris a contribué depuis plus de 20 ans à faire admettre que les questions géopolitiques ne sont pas réservées à une élite, mais qu’elles concernent tout le monde. Nos travaux servent à nourrir la réflexion qui précède la décision politique.
Pourquoi avoir été l’un des premiers à mettre en avant le rôle du sport dans les relations internationales ?
P.B. - Depuis plus de 15 ans, j’essaie de faire reconnaître le sport comme une réalité géopolitique, on me riait au nez à l’époque, aujourd’hui c’est reconnu. Les JO de Sotchi, la coupe du monde de football au Qatar et la nomination par Laurent Fabius d’un ambassadeur du sport en sont quelques preuves. Dans les relations internationales il y a le « hard power », le pouvoir de contrainte économique ou militaire, et le « soft power », le pouvoir d’influence, d’être attractif. Le sport est devenu un nouveau terrain d’affrontement symbolique entre les états, c’est une façon de rayonner. Tout le monde connaît Usain Bolt ou Cristiano Ronaldo alors que très peu de gens pourraient citer le nom du Premier Ministre jamaïquain ou portugais. Au moment où la mondialisation fait perdre les repères, où les identités nationales sont un peu remises en cause, le sport vient les susciter au travers de nations qui se réunissent autour de leur champion, au-delà des querelles idéologiques et culturelles.
Un coût exorbitant, de nombreux scandales, est-ce que les Jeux devaient avoir lieu à Sotchi ?
P.B. - Les grandes compétitions sportives internationales ne peuvent pas avoir lieu uniquement dans les pays occidentaux. Cependant, on ne peut être que partagé pour Sotchi. Il y a des dépenses somptuaires qui ont été faites, un non-respect des normes écologiques, des appropriations de terrains à la légalité douteuse, des malversations. C’est un triomphe pour Poutine, qui a réussi avec ces Jeux à mettre de nouveau la Russie au centre de la carte du monde, même s’il a dû faire quelques concessions et devra rendre des comptes à sa société civile. Cela dit, ce ne sont pas uniquement les Jeux de Poutine, les russes sont fiers d’accueillir cette grande fête du sport. On oublie trop souvent que ce peuple a été profondément humilié dans les années 1990, quand l’URSS, cette super puissance trop imposante, s’est transformée en pays trop faibles qui ont été méprisés par le monde entier. Il y a aujourd’hui une sorte de réflexe patriotique très fort chez les russes. Le boycott était impensable. Pourquoi le sport serait-il le seul domaine où l’on imposerait le boycott alors que l’on commerce avec la Russie dans tous les autres domaines, y compris intellectuel ? Maintenant, que certains chefs d’états n’aient pas voulu s’y rendre pour ne pas accorder un blanc-seing à Poutine, c’est autre chose.
Pourquoi vous intéresser dans votre dernier livre aux idées reçues sur l’état du monde, et comment va-t-il en 2014 ?
P.B. - On a trop tendance à penser que le monde doit être à l’image de la France. Alors que si les anglais, les japonais, les brésiliens ne pensent pas comme nous, ce n’est pas pour autant qu’ils sont idiots ou pervers mais ils n’ont pas la même histoire. Il faut toujours se mettre à la place de l’autre pour comprendre son point de vue, cela dynamiterait beaucoup d’idées reçues qui s’imposent à force d’être répétées et non pour leur bien-fondé. Sur l’état du monde, on assiste à deux changements fondamentaux : la fin de 5 siècles de monopole occidental sur la puissance, non pas à cause d’un déclin mais parce que les brésiliens, les sud-africains, les chinois progressent et n’entendent plus se laisser dicter leur conduite. Autre grande évolution, c’en est fini du monopole des gouvernements sur l’information, avec le développement des nouvelles technologies. Il y a toujours des différences entre démocratie et régime autoritaire, mais il n’y a plus de régime totalitaire, mis à part la Corée du Nord.
Comment peuvent évoluer les conflits ou situations délicates dans les mois à venir ?
P.B. - Le conflit syrien est le plus sanglant de ce début de siècle et l’on voit mal comment il pourrait prendre fin rapidement. Bachar el-Assad a réussi son pari de militariser une révolution pacifique pour la transformer en guerre civile et ethnique particulièrement cruelle et violente. La solution passe par le départ de Bachar el-Assad, et on ne pourra pas l’obtenir sans un changement d’attitude de la Russie et de l’Iran à son égard. Pour cela, ces deux pays doivent être sûrs que leurs intérêts seront préservés.
Il y a aussi des inquiétudes sur ce qui se passe au Sud Soudan et en Centrafrique, où cela peut dégénérer rapidement. Le grand motif d’espoir est l’Iran, où l’on a l’impression que le conflit larvé avec l’Occident qui dure depuis 34 ans est en train de prendre fin. Enfin, l’opposition entre la Chine et le Japon à propos d’ilots inhabités est apparemment contrôlée, mais si la situation dérapait entre ces deux géants asiatiques, cela aurait des conséquences mondiales.
Comment jugez-vous la politique internationale de François Hollande ?
P.B. - Lui qui n’était pas considéré comme un spécialiste des questions internationales, a réussi à calmer les relations avec le Mexique, la Turquie et le Japon, mais on attend encore un grand discours fondateur sur ce que doit être la France dans le monde. A son crédit, alors qu’il était accusé de procrastination, il y a l’intervention au Mali qui a eu un gros impact à l’étranger, notamment aux Etats-Unis. Pouvoir décider une intervention en 24 heures avec 3000 hommes a impressionné, d’autant qu’elle a été couronnée de succès. En ce qui concerne la Centrafrique, l’opération était nécessaire pour éviter un nouveau Rwanda, mais plus compliquée puisqu’il s’agit d’une guerre civile. Il faudrait que les autres pays européens et africains assument leur part de responsabilité.
Pourquoi le peuple ukrainien se bat pour intégrer l’Union Européenne, alors que les français s’en désintéressent complètement ?
P.B. - L’Ukraine a toujours été partagée entre l’option russe et l’option européenne. Alors que les russes aujourd’hui leur promettent une aide de 15 milliards de dollars, les ukrainiens préfèrent l’Europe qui pourtant n’est pas en mesure de leur apporter cette aide. Ce peuple fait preuve d’une grande maturité politique et démocratique en voyant son intérêt sur le long terme. Aller vers l’Europe signifie pour eux, la lutte contre la corruption et les oligarchies, une gouvernance différente. Il y a actuellement un rejet du régime de Ianoukovitch et de ses liens avec la Russie qui favorisent un immobilisme politique. Souhaitons la mise en place d’élections anticipées et le départ du président ukrainien pour éviter une guerre civile.
On s’aperçoit qu’il y a un désir d’Europe en dehors de l’Europe et une fatigue de l’Europe au sein de l’Union. Les français sont très facilement critiques vis-à-vis de l’Europe et on peut craindre aux élections européennes, un fort taux d’abstention et un important vote protestataire sur la politique nationale et non européenne. Les citoyens européens se détournent de plus en plus des élections alors que le Parlement européen n’a jamais eu autant de pouvoir. Même les partis politiques constituent leurs listes en recasant ceux qui ont été battu au suffrage universel. Il y a un paradoxe incompréhensible.
Repères biographiques
Docteur en droit international, à près de 58 ans Pascal Boniface enseigne les sciences-politiques spécialisées en relations internationales à l’université Paris 8, dirige l’Iris qu’il a fondé en 1991, et se déplace une semaine par mois à l’étranger. Il intervient régulièrement dans l’émission C dans l’air sur France 5 et dans d’autres médias. Il fait également partie du Conseil de l’éthique de la Fédération française de football.